Occupons le vote
par Vincent Casanova, Joseph Confavreux, Laurence Duchêne, Dominique Dupart, Xavier de La Porte, Aude Lalande, Philippe Mangeot, Victoire Patouillard, Antoine Perrot, Laure Vermeersch, Sophie Wahnich, Lise Wajeman & Pierre Zaoui
Nous, Vacarme, déclarons que nos amis qui ne votent pas et s’en justifient, tout comme les défenseurs du vote blanc, sans parler des derniers tenants du « vote révolutionnaire », commencent à nous fatiguer sérieusement. Parce qu’ils accordent bien trop d’importance au vote, au fond le sacralisent autant que le principe de représentation, et nous obligent à y penser et à produire des contre-argumentations alors qu’on aimerait bien s’en débarrasser au plus vite et passer à des questions politiques plus sérieuses ou plus drôles. Voter dans nos démocraties malades est un acte politique faible, déritualisé, sans enjeux décisifs vu la proximité des politiques suivies par les deux grands partis susceptibles de gagner. Mais cela reste, malgré l’érosion de la participation, l’acte politique le mieux partagé. Car c’est bien souvent le dernier acte politique commun que l’on peut partager non seulement avec sa famille, ses voisins de palier, sa chef ou son boulanger, mais encore, pour parler comme J. D. Salinger, avec une grosse dame que l’on ne connaît pas et que l’on ne connaîtra jamais, qui habite au loin, qui est vieille et malade, regarde toute la journée les informations dans un fauteuil en osier, mais se lèvera pour aller voter et aux deux tours. Il y a là comme un parfum de fraternité invisible et insue sur laquelle on ne crachera jamais et que les débats trop savants sur la légitimité du vote nous gâchent un peu. Il y a aussi une forme de beauté dans l’idée simplement égalitaire qu’une voix compte autant qu’une autre. S’il est certain, comme le disait autrefois Gilles Deleuze, qu’à chaque élection le niveau de connerie collective monte, et particulièrement pour les élections présidentielles, écrasant toutes les distinctions subtiles sous une lutte des camps bien plus indigeste et mensongère que la lutte des classes et diluant toutes les propositions un peu novatrices sous une langue de bois, on ne peut pas refuser complètement a priori une telle diminution de la vie de l’esprit. Ernesto Laclau a sur ce point des arguments assez costauds : pas de politique démocratique sans simplification et populisme bien compris. Ce qu’on peut entendre très simplement : aimer la politique c’est assumer aussi un certain amour de la connerie, ou une certaine pitié pour les cons (y compris, et avant tout, tous ceux qu’on cache en soi), ou au moins une dialectique un peu plus subtile entre l’esprit de finesse et l’esprit de connerie. A contrario, ceux qui refusent tout le rituel électoral et méprisent la bêtise et l’inculture de notre personnel politique, certes incontestables aujourd’hui, risquent non seulement de finir par nous dépolitiser complètement à force de raisonnements intelligents mais par ne même pas parvenir à cacher leur propre sottise (parce que crier « tous les mêmes », en termes de simplisme et de populisme, ça se pose là aussi). Pour ces deux raisons, et pour tous ceux qui partagent la même fatigue, nous avons décidé d’écrire ce texte. Nous le faisons une fois. Et puis plus jamais.
merde à la morale
On connaît les arguments pour arrêter de voter. Ils sont souvent avancés par ceux qui sont aujourd’hui le plus constamment engagés sur le terrain, et ils ont de quoi ébranler. Le vrai geste libre serait de ne pas donner sa voix, de ne pas mettre son bulletin dans l’urne, et de faire de ce refus la pointe militante d’une critique.
Pourquoi voter quand la vraie démocratie se joue ailleurs, dans les marges du jeu institutionnel ? Quand sur la Puerta del Sol, chez les Indignés, dans les mouvements Occupy, dans les associations, chez certains chercheurs, se sont inventés et se pratiquent des formes de délibération, de prise de décision et de désignation des porte-parole qui apparaissent comme des critiques en acte de la logique aristocratique de l’élection ?
Pourquoi voter pour mettre un chef à la place d’un autre, dans un régime présidentialiste qui préfère l’amour d’un seul à la délibération du Parlement, sans même parler des quartiers et des entreprises, des conseils et des soviets comme on disait autrefois ?

Pourquoi voter quand cela revient à légitimer le grand barnum des campagnes : omniprésence des sondages d’opinion et de leurs commentaires, personnalisation à outrance, imposition des problématiques par les logiques médiatiques, etc. ?
Pourquoi voter quand les programmes, en raison de la logique électorale, ne se permettent plus la moindre ambition ? Il y a quelque chose de désespérant à comparer ce que produisent les laboratoires d’idées des partis de gauche et ce qui s’énonce dans les propositions des candidats.
Pourquoi voter tous les quatre ou cinq ans quand agences de notations et marché votent au jour le jour, imposant des politiques qui ne sont pas soumises à délibération, et, le cas échéant, font et défont les gouvernements ?
Pourquoi continuer d’aller voter au terme d’une décennie traumatique, dont le principal enseignement est que les politiques tiennent si peu compte des raisons qui les ont menés au pouvoir, et parfois même des résultats ? Qu’on se souvienne de Jacques Chirac, majoritairement élu par des voix de gauche le 5 mai 2002, et qui ne tira d’autre leçon du 21 avril que la nécessité d’opérer un franc virage à droite. Qu’on se rappelle la façon dont fut entendue la victoire du « non » au référendum sur le traité constitutionnel européen (TCE) en 2005, avec l’interruption d’un processus de consultation populaire dans les autres pays d’Europe et l’adoption en 2007 d’un traité modificatif de Lisbonne qui institue, sans le moindre contrôle citoyen, ce qui avait motivé le refus du TCE deux ans auparavant. Et qu’on se rappelle plus encore la manière dont ce « non » est entendu aujourd’hui par les candidats à la présidentielle comme un appel à oublier l’Europe. À quoi bon voter quand les interprétations que ceux qui nous gouvernent ou aimeraient nous gouverner sont toujours les plus basses et les plus lâches ?
D’autant que face à de telles questions, il est insupportable de réentendre le vieux discours de la « gauche morale et responsable ». En particulier trois contre-arguments particulièrement culpabilisateurs. Celui qui rappelle que le vote est un droit acquis de haute lutte, « pour lequel beaucoup sont morts dans l’Histoire et continuent de mourir dans le monde ». Cet argument est infantilisant et revient, en gros, à dire à un môme de finir son assiette parce qu’il y a la faim dans le monde. Celui qui énonce doctement que le vote est un devoir. Parce que ce principe de morale républicaine se résume le plus souvent à une tautologie, « il faut voter parce qu’il faut voter », et exempte de s’interroger sur la désaffection du vote. Et le pire de tous, celui qui prétend que ne pas voter ou voter blanc c’est de facto voter Sarkozy, ou Hollande sinon Le Pen, en tout cas pour le vainqueur. Contre-argument d’allure sartrienne — ne pas vouloir choisir, c’est encore choisir, et acquiescer d’avance au choix majoritaire des autres — mais effectivement le plus culpabilisateur et surtout le plus bête : à raisonner comme Sartre on finit par dire que « même un enfant est responsable de la guerre » — et c’est plus que bête, c’est abject.
De surcroît, en raison même de leur moralisme culpabilisateur, ces contre-arguments sont triplement contre-productifs. Ils sont vains contre ceux qui ne votent pas pour des raisons morales : voter, sans pleine adhésion aux idées de celles et ceux pour qui on vote, sera toujours un geste impur, et on ne convainc pas des âmes morales, donc éperdues de pureté, en défendant un geste impur pour des raisons elles-mêmes morales. Ensuite, par définition, on ne convaincra pas, et même au contraire, ceux qui ne votent pas pour des raisons politiques, ne supportant plus depuis des lustres la petite morale des bien-votants comme on dit les bien-pensants. Enfin, on ne convaincra pas ceux qui ne votent pas parce qu’ils se foutent et de la morale et de la politique.
C’est pourquoi il faut en chercher d’autres, non plus moraux mais politiques. Arguments politiques contre les âmes morales qui ne votent pas : la politique n’est pas l’art de délibérer du bien mais de choisir le meilleur ou le moins pire (c’est exactement la même chose), et merde à la morale — on ne se damnera ni ne se sauvera en votant, alors arrêtons sur ce terrain. Arguments politiques contre les âmes politiques : dans quelle stratégie politique s’inscrit notre vote et dans quelle stratégie s’inscrit votre non-vote, comparons et que le meilleur convainque l’autre, c’est le jeu. Et arguments politiques contre les amoraux apolitiques parce que dans la politique, et non dans la morale, il y a toujours autre chose que de la politique et de la morale : du rire, du jeu, de la vie. Faire de la politique, c’est toujours aussi faire autre chose que de la politique. Y compris quand on vote.
C’est tout cela qu’il faut rappeler. Mais alors avec quels autres arguments, plus proprement et improprement politiques ?
communauté du non
Premier argument, le plus faible, mais le premier : votons en 2012 pour barrer la route à Sarkozy. Certes, c’est encore une fois voter contre. Mais ce vote contre aujourd’hui, cette sorte de vote noir, bilieux, atrabilaire, ce vote du pas-content-qui-ne-sourit-pas et qui s’opposerait au vote adulte, mature, engagé, réfléchi, le vote de celui qui a bien lu tous les programmes (et qui n’existe peut-être pas), ce vote dont il est coutume de se plaindre parce qu’il serait devenu le signe mélancolique de nos démocraties de masses occidentales, ce vote-là, en 2012, sera vivant. Ce président a érigé en gouvernement un système dont tout ou presque a déjà été dit. Il est temps néanmoins d’articuler nos griefs en raisons positives. Le racisme d’État qui est devenu la voix commune de tout un gouvernement, avant et après remaniement, construit un front de guerre qui a besoin de toutes les voix pour être vaincu et le vote contre se légitime alors doublement : parce qu’il articule le désir d’en finir avec une politique qui ne cesse de dresser les pauvres contre les pauvres en vertu d’une prétendue défense de la laïcité et en criminalisant sans cesse les populations issues de l’immigration, et parce qu’il veut aussi se faire l’écho de la décision historique du Sénat concernant le droit de vote des étrangers. Le vote du Sénat n’est pas seulement un vote symbolique : il programme à plus ou moins long terme au menu de la délibération parlementaire la discussion de cet enjeu dans l’histoire de la démocratie. Voter contre, c’est se donner la chance qu’une telle délibération advienne pleinement. Une autre raison de voter contre sans s’engager pleinement derrière un représentant plutôt qu’un autre : le démantèlement du service public. Si Sarkozy est réélu, en effet, c’est l’autoroute pour la mise en place durable et définitive d’un modèle néo-libéral, à la façon d’un Reagan ou d’une Thatcher auxquels le temps n’a pas manqué pour imposer un nouveau modèle de société, celui-là même que nous ne voulons pas. Sans parler du désir de se débarrasser de la république des petits chefs qui s’est insidieusement mise en place et qui gouverne les fonctionnaires à coup de mises à pied, de blâmes, de promesses de primes ou d’agitation du devoir de réserve. Enfin, la politique du fait-divers qui envahit l’espace public et qui revient à placer en criterium du politique le crime dégueulasse ou le viol immonde, nous voulons aussi, plus que tout, nous en débarrasser. Parce que nous sommes fatigués d’une clique raciste, xénophobe, autoritariste, nous prendrons donc avec joie le chemin du vote-sanction, comme l’appellent les journalistes. La criminalisation ouverte, affichée, successive de toutes les catégories les plus fragiles de la société, des mineurs transformés en délinquants aux fous transformés en déviants à enfermer, en passant par les Roms à évacuer, nous n’en voulons plus. Et d’abord pour des raisons politiques.
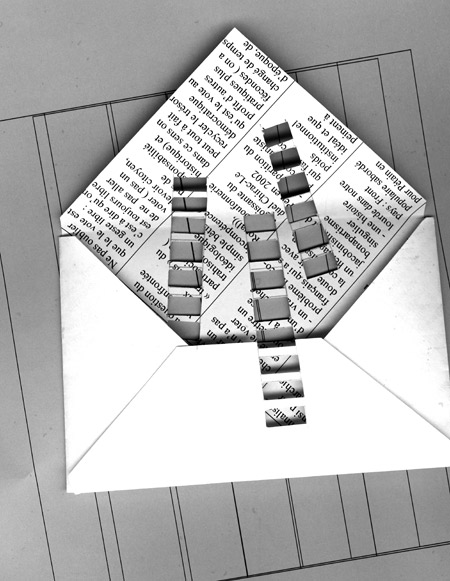
Car la seule question qui vaille n’est pas de savoir jusqu’à quel point le nouvel et innommé avatar de la gauche plurielle qu’on nous propose aujourd’hui contre Sarkozy pourra s’avérer réellement hermétique à la néo-libéralisation, continue depuis trente ans, du capitalisme d’aujourd’hui. La seule question est double. Elle est de savoir d’une part si, quelle que soit la forme que puisse prendre un gouvernement alternatif au sarkozysme, il pourrait s’avérer pire encore que l’actuel, et d’autre part de savoir si une politique du pire est aujourd’hui souhaitable ou non. Or, à la première question, la réponse est clairement non, ça ne peut pas être pire : quels que soient les compromis du PS avec les marchés et ses frilosités en termes de mœurs et de culture, quels que soient les absurdes calculs politiciens d’EELV et ses incompréhensibles querelles de chapelle, quels que soient les relents nationalistes douteux du mélenchonisme, ce ne peut pas être pire. De ce point de vue, peu importe pour qui l’on votera au premier tour, chacun peut faire les calculs qu’il estime justes car bien malin qui dira d’avance lesquels seront les plus justes ou les plus efficaces : l’essentiel est que s’en dégage une alternative crédible, aussi ténue soit-elle. Car à la seconde question il faut répondre non aussi. Les mouvements de contestation extra-gouvernementaux en Grèce, en Espagne, en Angleterre, se trouvent-ils mieux de faire face à des gouvernements explicitement néo-libéraux ? Qui peut le prétendre ? La question du (non)-vote du pire n’est pas une question absurde, c’est la question de l’influence du gouvernement sur les mouvements sociaux avant et après le vote. Après tout, on peut bien penser que les sept ans de giscardisme furent moins terribles que les années Mitterrand. Mais les temps ont changé et cette question nous semble exiger une réponse claire depuis trente ans : le néo-libéralisme est une nouvelle stratégie pour mettre à sac les mouvements sociaux, pour s’appuyer même dessus afin de les briser et d’aller un peu plus loin. Cette stratégie du choc et de la provocation frontale est déjà en soi une politique du pire : croire qu’on peut y résister en lui abandonnant tous les leviers institutionnels est une parfaite illusion. Il faut préférer aujourd’hui l’équipe B du capitalisme, sans aucun doute possible : non parce qu’elle serait meilleure en soi et à tous les niveaux, mais parce qu’on peut espérer davantage lui résister.
du contre au pour : des impôts et des écoles
Si l’on en croit les programmes de tous les candidats à la gauche de Bayrou, il y a au moins un point où le vote contre peut devenir un vote pour : l’impôt. Changer profondément la fiscalité française, c’est-à-dire reprendre la main sur ce qui a été abandonné par la gauche depuis les années 1990 dans tous les pays industrialisés ou presque. Nul doute que l’idée d’une révolution fiscale ne fait rêver personne, et pourtant, elle n’est rien moins que le cœur du problème de nos sociétés.
Au moins trois arguments le prouvent : d’abord, c’est l’abaissement des taux d’imposition des ménages les plus aisés qui a contribué à réduire substantiellement les recettes fiscales et a permis de justifier que la lutte contre les déficits publics rende presque non négociables les baisses des dépenses. Ensuite, c’est l’opacité du système fiscal qui mine le lien social en entretenant, voire en créant, une méfiance généralisée, un soupçon que l’autre est toujours mieux loti que soi, ou que l’autre n’a pas eu à payer ce qui nous coûte si cher. Or, cette méfiance est non seulement le terreau de l’extrême-droite mais apparaît aujourd’hui, même aux économistes (voir l’ouvrage remarqué de Yann Algan et Pierre Cahuc, La Société de défiance, 2006), comme un handicap majeur à l’innovation économique et plus globalement à la croissance. Enfin, ce sont les politiques fiscales qui différencient les gouvernements nationaux et manifestent les choix politiques des citoyens : face à une harmonisation à la baisse des taux d’impôt sur le revenu, face à la concurrence fiscale sur l’impôt sur les sociétés (Irlande en tête), face à la quasi-disparition des droits de succession (notamment dans l’Italie de Silvio Berlusconi) qui sont pourtant le principal moyen de réduire un peu les inégalités à la naissance, ou plutôt d’empêcher la formation d’aristocraties économiques figées, il est plus que temps de hurler.
Hurler que nous ne voulons plus que les plus riches voient leurs contributions diminuer quand la TVA pèse plus lourdement sur les plus pauvres. Hurler que nous savons aujourd’hui que l’impôt sur le revenu en France est régressif surtout pour les 0,1% les plus riches (qui en moyenne ont un taux d’imposition de 35% contre plus de 40% pour les 10% les plus démunis). Hurler que ce système inégalitaire est miné par les niches fiscales, les exemptions de taxation sur les hauts revenus et surtout par la moindre taxation des revenus du capital.

Car, après tout, ce n’est pas comme si nous ne savions pas où tout ceci nous mène : les États-Unis et la Grande-Bretagne nous ont montré la voie, et les résultats parlent d’eux-mêmes. Plus de 46 millions d’Américains vivent désormais sous le seuil de pauvreté (fixé à 22 000 dollars par an pour une famille de quatre personnes), « un record depuis 52 ans que le bureau de recensement comptabilise ces données » (selon Thomas Cantaloube, Mediapart, 15 septembre 2011). « En dollars constants, le revenu moyen d’un foyer a diminué de 7% depuis son apogée en 1999 et se retrouve au même niveau qu’en 1996 » ; et toujours depuis 1999, « les 10% de foyers les plus pauvres ont perdu 12,1% de leurs revenus […] alors que les 10% les plus riches perdaient seulement 1,5%. Quant aux 1% des foyers les plus riches des États-Unis, ils ont vu leurs revenus augmenter, et aujourd’hui, ils gagnent autant que la moitié la plus pauvre du pays ! ».
Quant au Royaume Uni, la dernière enquête de l’OCDE sur les inégalités estime qu’il est le quatrième pays (après le Mexique, les États-Unis et Israël) à avoir connu la plus forte progression des inégalités. Les 10% les plus riches y ont en effet vu leur revenu réel croître en moyenne de 2,5% du milieu des années 1980 à la fin des années 2000 alors que les 10% les plus pauvres n’ont vu le leur augmenter en moyenne que de 0,9% par an. C’est encore pire en Israël où le premier décile a connu une croissance moyenne de son revenu réel de 2,4% tandis que le dernier décile a subi une baisse du sien de 1,1% en moyenne par an. Plus généralement, dans la zone OCDE « le revenu moyen du décile le plus riche de la population est aujourd’hui environ neuf fois celui du décile le plus pauvre, soit un ratio de 9 à 1. Ce ratio est toutefois très variable d’un pays à l’autre. Il est très inférieur à la moyenne de l’OCDE dans les pays nordiques et dans de nombreux pays d’Europe continentale, mais monte à 10 en Corée, en Italie, au Japon et au Royaume Uni ; à 14 aux États-Unis, en Israël et en Turquie : et à 27 au Chili et au Mexique » (p. 3 du résumé du rapport de l’OCDE).
Or l’un des enseignements de ce rapport est le constat que jusqu’au milieu des années 1990 « les dispositifs fiscaux et sociaux de nombreux pays de l’OCDE compensaient plus de la moitié de la hausse des inégalités des revenus marchands. [Mais] alors que ces inégalités ont poursuivi leur progression après le milieu des années 1990, la plus grande part de l’effet de stabilisation des impôts et des prestations sur les inégalités de revenus des ménages a reculé » (p. 17). Ainsi, une refonte de la fiscalité visant à lui redonner, ainsi qu’à la politique sociale, les moyens de corriger beaucoup plus fortement les inégalités de revenus des ménages est bien indispensable, même l’OCDE le suggère ! Évidemment, une telle révolution fiscale ne saurait faire changer à elle seule le monde, mais nous défendons qu’elle en est un moyen incontournable, à mettre en œuvre immédiatement.
Par ailleurs, et parce que nous pensons, avec l’OCDE, que « toute stratégie visant à réduire la fracture croissante entre les riches et les pauvres devrait reposer sur trois grands piliers : un regain d’intensité des investissements dans le capital humain ; une politique solidaire en matière d’emploi ; et l’existence de politiques redistributives fiscales et sociales de qualité », il nous faut ajouter au moins une deuxième raison d’aller voter en avril prochain : l’éducation. En matière d’investissement en capital humain, l’Éducation nationale, ou l’éducation tout court, a été passablement laminée par le gouvernement de droite que nous subissons. Que la gauche fasse vraiment mieux n’est pas sûr. Mais elle pourrait difficilement faire pire. Et qu’elle annonce prendre enfin en compte, à juste titre, la maternelle et l’élémentaire, est un début qui nous intéresse — quand bien même ce ne serait qu’un début, ou un minimum.
avant, pendant, après : puissance de perturbation
Voter contre un pouvoir en place, voter pour une partie de programme, ne fait sauter personne de joie. Mais reste dans l’expression populaire qu’est le vote la possibilité d’une perturbation rappelant à ceux qui l’auraient oubliée que nos gouvernants préféreraient faire sans nous. Quand François Baroin, ministre de l’Économie et des Finances, explique à l’Assemblée Nationale que les socialistes sont arrivés au pouvoir en 1997 « par effraction », il nous donne l’agréable — et inquiétante il faut l’avouer — impression que certaines victoires électorales parfaitement régulières sont ressenties comme des cambriolages. Quand presque partout en Europe s’élèvent les protestations de responsables politiques contre l’idée saugrenue de l’ex-Premier Ministre grec Georges Papandréou de soumettre l’accord passé entre l’Union européenne et son pays à un référendum populaire, les masques tombent : aurait-il été si fou de demander aux Grecs leur avis ? Certes, ces ingrats de Grecs auraient pu refuser. Mais n’est-ce pas ce qu’on appelle la démocratie ? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, nos élus craignent le vote. Impossible alors de ne pas profiter de ce rare pouvoir qu’ils nous concèdent.
D’ailleurs, le refus de la droite d’étendre le droit de vote aux étrangers aux élections locales, et le peu d’empressement de la gauche à l’imposer, constituent une autre manifestation de son pouvoir perturbateur. Le vote des résidents extra-communautaires fait peur à la majorité gouvernementale, à l’image de Claude Guéant, le ministre de l’Intérieur, qui brandit la menace communautariste, les étrangers étant voués, selon lui, à choisir des non-Français pour représentants. Ce vote inquiète au-delà tous ceux qui considèrent que cette question n’est pas une priorité ou qui refusent de délier citoyenneté et nationalité aux élections locales, au point d’exclure environ deux millions d’individus de la communauté politique.
Les étrangers ne sont pas les seuls à être mis au ban. Les jeunes, les pauvres, les « nomades » et les détenus sont aussi tenus à l’écart. Nombre d’électeurs en effet ne se déplacent pas lors des élections, non par choix, mais parce qu’ils sont de fait écartés du vote. Aux obstacles dressés sur le chemin des nouveaux inscrits s’ajoutent les difficultés liées à la condition de domiciliation. Depuis la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, votée le 29 juillet 1998, les personnes sans domicile fixe peuvent, en principe, s’inscrire sur les listes en demandant le rattachement à un organisme d’accueil, mais faute de réelle campagne d’information, ce texte a peu d’effets. Les gens du voyage bénéficient, eux, d’un dispositif dérogatoire, qui se révèle plus discriminant qu’efficace : ils doivent justifier de trois ans d’installation dans une commune, contre six mois selon la règle générale. Parmi les détenus qui ne sont pas déchus de leurs droits civiques, rares sont ceux qui exercent leurs droits car ceux-ci sont largement subordonnés à la volonté défaillante de l’administration pénitentiaire. Le peu d’efforts consacrés par les responsables politiques à intégrer ces ignorés du vote devrait être considéré comme un autre signe de la capacité perturbatrice du vote.

Cette puissance du vote se lit aussi, en creux, dans les moments où les personnes au pouvoir ne l’ont pas pris en compte. Or ne pas vouloir prendre en compte l’expression de la volonté populaire exprimée dans les urnes est un très mauvais calcul. Ni les institutions européennes, ni les gouvernements nationaux ne se sont saisis des référendum français et hollandais sur la Constitution européenne, en 2005, pour mettre en œuvre une Europe plus démocratique. Et c’est aussi ce qui fragilise le projet européen aujourd’hui. La puissance du vote, c’est que son résultat, s’il peut être ignoré, n’est jamais sans conséquence.
De ce dernier point de vue, aussi important que le moment d’avant le vote, importe le moment d’après le vote. Or comment penser les stratégies sociales d’après vote sans penser au vote lui-même ? On ne peut que soutenir une conception pleinement pragmatique du vote parce qu’elle est paradoxalement un bon gage pour l’avenir : savoir que l’on vote pour se donner de meilleures conditions pour les luttes et résistances qui suivront, c’est se préserver d’avance de la déception et de la désillusion. Il faut se souvenir ici que les fers de lance des déçus du socialisme, du blairisme et de l’obamisme sont constitués très majoritairement à la fois par ceux qui n’avaient pas voté pour eux et par ceux qui n’avaient fait que voter pour eux.
merde aux croyants
Considérer que le vote est question moins d’espérance et de crainte que de calcul stratégique, c’est se prémunir d’avance contre ces postures boudeuses et infantiles. « Ah, Mitterrand, tu m’as bien déçu », c’est la rengaine chantée par ceux qui refusent de penser sincèrement le vote pour ce qu’il est : un simple moment dans un faisceau de stratégies politiques plus larges.
Défendre une conception pragmatique, non simplement de son vote, mais surtout du moment politique du vote, c’est renoncer d’avance à l’illusion qu’il puisse « changer la vie » et le détacher de ce qu’il trimbale encore de sacralité, de fétichisme et de croyance. Le vote que nous défendons n’est pas un vote de croyance : ce n’est pas le vote de ceux qui ne croient plus, ni le vote de ceux qui espèrent croire, c’est celui qui refuse la téléologie du vote, pour privilégier les pensées du possible.
Ce qui suppose de découpler le vote de l’idée de la représentation : si l’on observe l’offre politique actuelle, il faut beaucoup d’abnégation en effet pour espérer être représenté par les technocrates du PS, et beaucoup d’illusion pour envisager que sa voix puisse être seulement portée par eux. Il faut rien moins qu’une fiction, mais une fiction de celles qui ouvrent la porte à toutes les désillusions, et conduisent à dire que la gauche est, somme toute, pire que la droite, parce qu’elle déçoit toutes les espérances. Sauf que si c’était le cas, et suivant le principe rationnel, éminemment défendu par Spinoza, qu’entre deux maux il faut toujours choisir le moindre — y compris quand il s’agit d’une tristesse — il faudrait voter à droite.
Mais cela revient aussi à renoncer gaiement à l’idée d’un vote de confiance, fut-il conditionnel. Car il n’y a aucune raison de faire confiance à des gouvernants : les logiques de carrière politique, comme les jeux d’appareils, et sans parler même de ce qui est si souvent advenu des promesses électorales, n’inspirent ni ne justifient la moindre confiance. Mais il n’y a pas là de quoi renoncer au vote, et pas davantage de raisons de s’y rendre comme on va se pendre. Bien au contraire : car un vote allégé de sa confiance se voit affecté, en retour, d’une positivité stratégique. Il assume pleinement de n’être qu’un moment, parmi d’autres, de l’expression et du combat politique.
Vacarme a suffisamment soutenu que les mobilisations des gouvernés, loin de se limiter à l’expression d’une indignation, constituent pleinement une politique, pour savoir aussi que cette politique-là ne peut être indifférente à la sphère gouvernementale. Car la défiance dont elle procède à l’égard des gouvernements, et qui n’a nullement vocation à être résorbée, va de pair avec un travail constant pour leur imposer des formes de problématisation différentes et pour leur arracher de nouveaux droits, de nouvelles libertés, de nouvelles extensions du domaine de l’égalité. Or dans une telle perspective, la question de savoir qui occupe le pouvoir est cruciale. Ce n’est pas seulement une question de programme. C’est avant tout une question de marge de manœuvre. Voter, c’est choisir, parmi les candidats, ceux sur qui la critique des manières de gouverner, la mise en lumière du grand écart entre les pratiques et les principes dont elles s’autorisent, a le plus de chance de peser. C’est opter pour ceux que les mouvements de gouvernés sauront le mieux embarrasser. Et c’est aussi, par voie de conséquence, désigner des gouvernants sous le régime desquels de tels mouvements ont le plus de chances et de raisons d’advenir.
Dès lors, renoncer à participer aux échéances électorales au motif qu’elles seraient sans commune mesure avec des modes d’expérimentation politique plus démocratiques, est aussi stérile que souscrire à l’idée, fondamentalement rousseauiste, que le tout de la démocratie se joue dans les urnes une fois tous les quatre ou cinq ans, comme voudraient le faire croire tant de politiques et de commentateurs professionnels. Le peuple a voté ! et il n’a plus qu’à se taire. Qu’on se souvienne des argumentaires sarkozystes au moment de la réforme de la retraite : « Dans le fond, vous avez voté pour ce président, aussi votre contestation n’est pas légitime ». C’est le propre des régimes démocratiques autoritaires que de centrer toute la liberté politique sur le vote à l’exclusion de toutes les autres pratiques, en tentant même de les opposer les unes aux autres : la manifestation, légitime certes, mais moins légitime que le vote présidentiel, la grève, légitime certes, etc.… Mais l’abandon du vote n’est que l’envers de sa sacralité piégeante. Il faut décidément cesser d’accorder trop d’importance à ce petit geste pragmatique : parions que ce ne sont pas les élections, mêmes présidentielles et avec des candidats guère florissants, qui empêchent le plus grand nombre de se révolter (hypothèse haute) ou de lire des revues et des livres (hypothèse basse). Bien au contraire. Car si l’on admet qu’une large partie des avancées sociales et politiques est le fruit d’une « bataille perpétuelle » (pour emprunter une formule de Michel Foucault) entre gouvernants et gouvernés, choisir ses gouvernants est bien un moment incontournable de cette bataille.
Mais, objectera-t-on, ne faudrait-il pas, selon cette logique, désigner le pire des gouvernements, c’est-à-dire aussi le plus susceptible de susciter contre lui des mobilisations ? On répondra que l’expérience des dernières années devrait avoir, pour l’heure, disqualifié le scénario, cent fois annoncé et toujours démenti, des troisièmes tours sociaux. Loin de favoriser les investissements militants et syndicaux, le durcissement continu de la droite a eu pour effet, au mieux, de les acculer dans des combats pour la conservation de ce qui pouvait encore être sauvé face à une entreprise systématique de restriction des libertés publiques et d’accroissement des inégalités, au pire de les décourager. On ne s’est plus battu, ces dernières années, pour arracher des droits, mais pour empêcher qu’ils soient restreints. On n’a plus lutté pour le droit de vote des étrangers, pour la liberté de circulation, pour repenser l’enseignement secondaire et supérieur, on s’est mobilisé au cas par cas pour empêcher telle ou telle expulsion, on a tenté de faire front contre la mise à bas des protections dont bénéficiaient les étrangers malades, pourtant gagnées de haute lutte à la fin des années 1990, on a résisté contre la loi Libertés et responsabilités des universités adoptée contre la presque totalité des communautés universitaires. Ces combats ont tous été perdus, épuisant souvent les forces de ceux qui s’y étaient engagés. Et la tendance, amorcée depuis 2002, à la criminalisation du militantisme s’est encore aggravée.
Faut-il rappeler que la France est l’un des pays démocratiques où le droit de manifester sur la place publique est le plus sévèrement contrôlé ? Les Indignés de la Défense le savent, qui se sont efforcés pendant quelques semaines de préserver leurs maigres campements contre des assauts musclés de la Police sous les yeux ahuris des compagnons de route espagnols ou américains de passage. Quant aux autres formes d’occupations de l’espace public, occupations des locaux, manifestations de sans-papiers, occupations des logements vides, distributions de tentes, elles sont presque toujours menacées du spectre de l’illégal !

Voter à gauche, fût-ce pour des candidats un peu désolants, c’est donc choisir de restaurer un climat propice à la conflictualité sociale et aux engagements citoyens. Historiquement, l’extension du suffrage s’est accompagnée d’autres modes d’expression (développement des libertés publiques, rassemblements dans les rues, associations, théâtre militant critique). Jamais le suffrage — quand il a été pensé universel pour la seconde République — n’a été conçu seul, isolé des autres libertés. Par la suite, s’il demeure mais seulement détaché, coupé des autres libertés, alors la république ne se maintient plus que comme un spectre dont le coup de grâce est très vite donné par le coup d’État du 2 décembre puis par le plébiscite. On peut, par ailleurs, trouver parfois fatigante l’invocation incantatoire de 1936, comme si ce moment constituait le seul horizon de la gauche française, mais l’ampleur du mouvement de grèves qui suit immédiatement l’élection du Front populaire et prélude aux accords de Matignon, ainsi que l’augmentation considérable des adhésions syndicales qui s’ensuit, restent une référence. L’histoire, bien sûr, ne se répétera pas — impossible de croire aujourd’hui dans la conjonction de l’état de grâce et de l’ardeur militante qui caractérisa autrefois les débuts du Front populaire ; passée la joie d’en finir avec Sarkozy, il n’y aura pas d’état de grâce et ce sera très bien ainsi. Mais il faut travailler dès maintenant, dès avant le vote, pour qu’après le vote tous les mouvements sociaux encore vivants se saisissent de l’occasion pour empêcher que la brèche ouverte par la victoire électorale se referme trop vite : il y a aussi des Puerta del Sol et des Wall Street à occuper en France.
On aimerait croire, du reste, que les candidats actuels de la gauche comptent aussi sur ce scénario, qu’ils n’ont pas oublié le désastre de la gauche plurielle conduite par Lionel Jospin, dont l’accession au pouvoir doit beaucoup à l’énergie sociale et populaire de décembre 1995 ainsi qu’à celle des mobilisations des sans-papiers, des précaires, etc. qui animèrent les mois précédant l’élection : on sait comme elle s’appliqua aussitôt à éteindre cette énergie, réaffirmant la distinction entre gauche « politique » et gauche « sociale » et concédant hautainement à cette dernière quelques « guichets » où déposer des doléances renvoyées à leur « irréalisme ». Nous le payons encore aujourd’hui. Une fois au gouvernement, la gauche devra désormais savoir qu’elle a tout intérêt à trouver dans la rue, dans les syndicats, dans les mobilisations associatives, des contre-pouvoirs dont elle pourra s’autoriser pour secouer, notamment, le joug des marchés financiers, ou pour adopter des lois que la pusillanimité des candidats les font, au mieux, soutenir du bout des lèvres.
Si nous pensons en somme qu’il faut aller voter, c’est aussi pour obtenir que le moment du vote soit configuré autrement, en amont comme en aval. Car un peuple qui fait suffisamment peur pour qu’on ne se moque pas de lui, ce n’est pas un peuple qui dispose seulement du droit de vote mais un peuple « constamment délibérant ». C’est ainsi que les Thermidoriens avaient stigmatisé la période de l’an II, effrayante à leurs yeux car le peuple y était en effet sur le qui-vive, surveillant la qualité des lois qui se faisaient en son nom, surveillant la qualité des hommes qui agissaient en son nom, se réunissant très régulièrement pour ce faire dans des sections de quartier. C’est cette délibération qu’il s’agit de reconquérir et pour pouvoir lui donner forme, reconquérir des lieux. Nous sommes nombreux à avoir fait l’amère expérience de nous voir refuser une salle municipale pour avoir annoncé que l’enjeu de la réunion projetée n’était pas de faire du macramé mais bien de réfléchir collectivement et politiquement sans pour autant appartenir à un parti. La vie culturelle a été une manière de chasser la vie politique de proximité, celle où l’on noue les émotions et la raison dans la co-présence des corps. Et ce ne sont pas les conseils de quartier qui ne s’occupent que du quartier qui peuvent venir combler le manque, car la politique qui intéresse tout le monde dépasse bien sûr les bornes du quartier. Il faut voter pour réclamer que le vote ne soit plus tributaire d’un espace public confisqué aux simples quidams par les seuls partis et leur financement. Il faut voter pour arracher des lieux du politique. Pour pouvoir construire les rapports de force, les argumentaires, les outils, faire du vote un moment procédural et non l’alpha et l’oméga de la vie politique française, européenne, mondiale. Il faut entendre que si le vote n’est pas l’assurance d’une maturité démocratique, la capacité de tous à devenir des citoyens délibérant sur les affaires publiques passe par lui, a besoin de passer par lui.
« Il faut, disait Nicolas de Bonneville en 1791, que le peuple dont la liberté n’est pas imperturbablement affermie soit toujours sur le qui vive, il doit craindre le repos comme l’avant coureur de son indifférence pour le bien public et se faire une habitude de contredire et de disputer pour n’être pas la dupe de tant de vertus vraies ou affectées par lesquelles on pourrait le tromper. » Une telle vigilance ne sera possible en aval que parce qu’elle aura été réfléchie en amont. On ne construit pas des rapports de force seul devant son téléviseur le soir des élections, mais en affirmant qu’occuper le vote est déjà un bon prélude pour occuper le terrain. Car si l’espace public nous a été volé comme on nous vole notre temps, il nous appartient.

conclusion en forme de post-scriptum
Dans un esprit d’impartialité on voudrait rappeler pour finir que, s’il y a de mauvais arguments pour ne pas aller voter les 22 avril, 6 mai, 10 et 17 juin prochains, il y a pléthore de bons : être étranger et se voir refuser ses demandes de naturalisation depuis 15 ans ; avoir moins de 18 ans ; être déchu de ses droits civiques ; avoir perdu son emploi sous Mitterrand et sa maison sous Jospin ; se faire voler tous ses papiers le matin du vote ; partir le matin des élections vers son bureau de vote et se faire renverser par une voiture ; se faire renverser par une voiture la veille des élections, même l’avant-veille, même par une moto, même une semaine avant si le choc fut mortel ; plus généralement mourir avant le vote d’un accident quelconque, ou d’un cancer, d’une leucémie, d’une attaque cardio-vasculaire, de la grippe espagnole, du rhume (dans tous ces cas, vraiment, soyons justes, rien à redire) ; être dans le coma ; apprendre au moment de rentrer dans l’isoloir que son mari et ses sept enfants viennent de périr dans un incendie ; être interné pour crise mélancolique grave le matin du premier tour, même le matin du second tour ; oublier jusqu’à son propre nom le jour J et errer toute la journée dans les rues en se demandant tout du long pourquoi cette hâte et ce sentiment d’urgence inquiet ; souffrir d’un raptus amnésique et ne plus se souvenir que Nicolas Sarkozy est notre président depuis cinq ans et risque de le demeurer. Tout de même, il y aurait là l’embarras du choix.