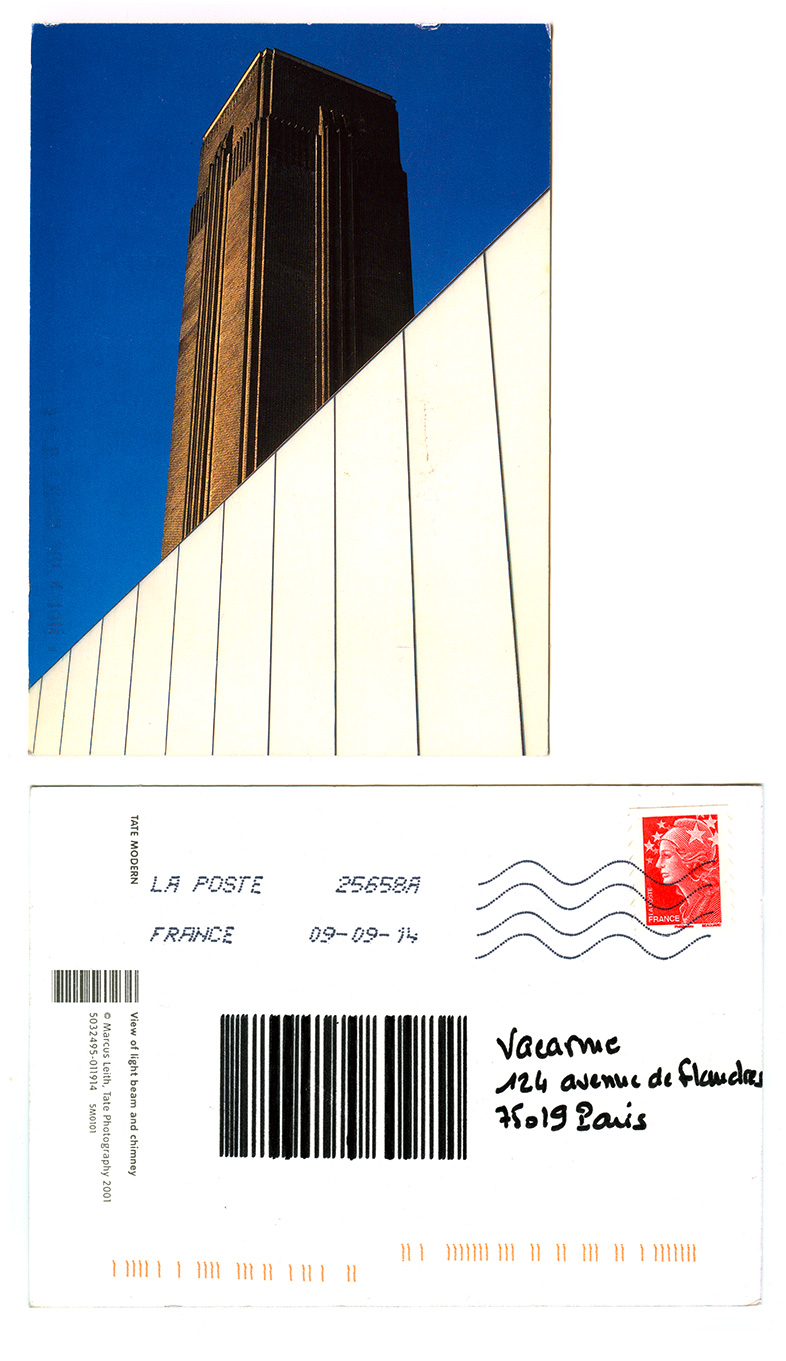Le troisième signe sur la série « Sherlock »
par Emmanuel Burdeau
Le Sherlock de la série britannique de Mark Gattis et Steven Moffat ressuscite le héros de Conan Doyle à l’âge de CNN et des applications pour smartphones. Machine à décoder, héros de l’éclairage intégral, il renseigne, à sa manière un peu grossière, sur le processus à l’œuvre dans les séries d’aujourd’hui : la « télévisualisation », cette aspiration à tout voir, à tout lire, à tout montrer. Mais le temps d’un épisode de la troisième saison, quand Sherlock, ce témoin absolu, est invité à devenir témoin, « Best man », du mariage de son ami Watson, le génie du déchiffrement perd ses moyens : tout ce qui a force d’évidence devient épaisseur, énigme, chiffre. « The sign of Three », pièce à conviction dans une enquête au long cours sur les liens problématiques entre télévision et visibilité.
La chaîne BBC One a diffusé le 5 janvier de cette année le deuxième épisode de la saison 3 de Sherlock. « The Sign of Three » diffère des habitudes de la série créée en 2010 par Mark Gattis et Steven Moffat. L’enjeu n’en est pas une enquête qui mettrait le détective londonien aux prises avec un serial killer malade ou quelque esprit surhumain projetant, par orgueil, de renverser le monde. La figure était incarnée jusque là par James Moriarty, version actualisée au début du XXIe siècle du terrible Dr. Moriarty d’Arthur Conan Doyle. Mais le terroriste mégalomane a été mis en hors d’état de nuire à la fin de la deuxième saison. Il a fallu pour cela que Sherlock succombe. Il a bien sûr plutôt fallu qu’il le fasse croire. Qu’il s’y emploie si bien que le docteur Watson le pleure encore quand, deux ans plus tard, débute l’action de la troisième saison. Composée comme les autres de trois épisodes seulement, d’une durée d’une heure trente chacun, celle-ci sera en partie consacrée à la résurrection de Sherlock, aux retrouvailles compliquées entre les deux hommes, à leur amitié aussi.
Dans le premier épisode de la nouvelle saison, Sherlock fait à son compagnon une surprise qu’il se figure plaisante mais qui tombe à plat. Au lieu d’une effusion de joie, sa réapparition d’entre les morts sous l’apparence d’un serveur portant fine moustache et parlant anglais avec l’accent français entraîne une cascade de colères et de coups de poing. Commencée dans l’établissement chic où Watson est venu demander la main de Mary, la situation rétrograde par étapes, à force d’échauffourées, jusqu’à un fast food miteux où Sherlock s’évertue à ne pas comprendre pourquoi la blague n’amuse pas son ami. Et l’enchaînement s’achève sur le trottoir où il se confirme que, bien que génial, le détective n’a aucune connaissance de la « nature humaine ». « Nature ? No », « Human ? No », répond-il en humant une fleur à Mary qui s’enquiert dans un sourire de ses connaissances en la matière.
Le gag donne le ton : il commence ici à se faire, à se refaire dans Sherlock un équilibre entre la vie et le travail, entre les signes de l’amitié liant les deux héros et ceux qu’ils trouvent sur leur chemin quand ils enquêtent. Les seconds, qui l’emportaient jusqu’à présent, sont en train de céder la priorité aux premiers. Le début de la saison offre ainsi les prémices d’un renversement qui trouvera à pleinement s’exprimer dans l’épisode suivant. Le titre de celui-ci, « Le signe de trois », ne désigne pas, en effet, le code secret de quelque machination machiavélique, mais la déduction faite par Sherlock, à certains symptômes décelables par nul autre que lui, que Mary est enceinte — ce dont les futurs parents ne s’étaient point encore alarmés.
Plus tôt, l’épisode se sera ouvert avec le triomphe de Lestrade, parvenant enfin à arrêter sur le fait une redoutable famille de cambrioleurs. L’inspecteur de Scotland Yard est néanmoins empêché de savourer sa victoire par l’arrivée d’un SMS de Sherlock l’appelant à l’aide de toute urgence. Accompagné d’un grand renfort de sirènes, Lestrade se précipite au 221B Baker Street pour trouver le détective, tête baissée devant son ordinateur, se lamentant de la difficulté qu’il doit affronter. Il a un livre à la main. Ce n’est pas un vieux grimoire, pas un épais dossier sur lequel il calerait depuis des années. C’est un ouvrage dont la couverture promet d’enseigner l’art de rédiger son discours, lorsqu’on est témoin à un mariage. Message reçu : le défi ne sera pas criminel, pour une fois, il sera humain. Il ne touchera pas à l’extraordinaire. Il s’adressera à l’ordinaire même : l’amour, l’amitié, les mots qu’il faut trouver pour les dire et les célébrer.
Une permutation a donc lieu entre l’évident et le chiffré, l’aisé et le difficile, l’insignifiant et l’essentiel.
Tout s’inverse, dans « The Sign of Three ». Les signes, les chiffres et les codes sur lesquels repose une série dont le héros est convaincu que c’est cela qui fait tourner le monde : les signes, les chiffres et les codes. Il semblerait que les fans n’aient que moyennement goûté ce changement de régime. Beaucoup ont jugé inopportune la digression au cours de laquelle le discours de Sherlock cesse d’évoquer quelques-unes des aventures partagées avec Watson pour parler en effet du mariage, des lois de l’amitié et, on va y venir, des différences entre l’enquête et la vie. Sur Imdb, l’épisode est le moins bien noté de la saison — de peu, il est vrai.
Il va s’agir ici de défendre la thèse inverse : ce renversement de sa hiérarchie est ce qui est arrivé de mieux à Sherlock. Les signes de l’amitié recouvrent un temps les signes de l’enquête ; le drame policier verse dans la comédie ; la lourdeur s’efface derrière la légèreté, l’emphase derrière le burlesque ; à la parole déductrice se susbtitue celle qui, engagée dans une tâche qu’elle méconnaît, ne sait bientôt plus ce qu’elle raconte ; le rapport se bouleverse, qui articule la personnalité des enquêteurs et la nature de leurs enquêtes, l’urgence de l’affaire en cours et celle des affects, la nécessité de démasquer un criminel et celle de délivrer devant un parterre un discours dont ni l’auteur, ni ses dédicataires n’aient trop à rougir.
Ce qui arrive à Sherlock dans « The Sign of Three » arrive à tous les récits mettant en scène des détectives. Cela arrivait à [la série dont il a été question au précédent numéro, justement intitulée True Detective. Vient un temps où le travail de l’enquête se met à concerner au premier chef les enquêteurs eux-mêmes. Vient un temps où le labeur de descendre aux sous-sols du monde pour y traquer l’inavouable doit laisser place à la remontée vers une double surface. C’est le plein jour enfin retrouvé de secrets désormais dévoilés. Et c’est l’apparence, la couverture de ceux-là mêmes qui sont descendus puis remontés. L’enquête de True Detective portait aussi sur Rust Cohle et sur Martin Hart. Elle portait sur la sagesse de l’un, cachée derrière ses théories fumeuses et ses écarts de tête brûlée. Et elle portait sur la folie de l’autre, tapie sous son bon caractère et son éloge du bonheur familial. Si tout finit par remonter à la surface, c’est donc que la surface est le sujet, et non seulement la profondeur. Les tréfonds du monde, mais aussi ce qui s’est toujours offert à l’œil nu et qu’on ne savait pas voir. Il est logique, en ce sens, que True Detective ait été construit à partir d’interrogatoires auxquels sont soumis les deux policiers : ce sont eux en effet, les suspects, même si ce n’est jamais que du crime d’être autres que ce qu’ils croient et donnent à croire qu’ils sont suspectés.
True Detective allait et venait entre le présent de ces interrogatoires et les différents passés d’une recherche étalée sur plusieurs années. « The Sign of Three » procède de façon similaire. Il y a toutefois une nuance : l’enflure et la frénésie de la série britannique ont peu à voir avec la langueur sudiste, elle-même teintée d’emphase il est vrai, de l’américaine. Une fois posé le décor du mariage, le récit va circuler entre l’accueil des invités, le cocktail, les photos et, bien sûr, le discours du best man et ce qui a eu lieu avant, quelques jours avant, où se mêlent les préparatifs du grand jour et les dernières aventures du duo. L’inversion des signes de l’enquête et des signes de l’ordinaire prend alors deux sens. D’une part les premiers, soudain, pèsent moins que les seconds. Et d’autre part Sherlock se met à exercer son génie déductif dans une direction inédite pour lui : s’il sait en un clin d’œil déchiffrer postures et vêtements, s’il repère par exemple à vingt pas un homme infidèle, d’après un index trop usé à taper des SMS en cachette, il n’a pas l’habitude d’utiliser ses capacités dans le cadre des usages et coutumes pratiqués en société.
L’objet de l’enquête est cette fois-ci la vie elle-même, le commun, le banal. Mariage, témoin, discours. La banalité de devoir se lever pour exprimer son affection, raconter quelques anecdotes et porter un toast. L’horreur pour qui, comme Sherlock, méprise ce qui n’est pas extraordinaire, incongru, spécial. Mieux : pour quelqu’un qui a appris à tout bonnement ignorer ce dont il n’a aucune utilité dans son travail. Sherlock Holmes connaît par cœur la carte de Londres, il sait ce que trahit une trace de sueur dans le cou ou une certaine manière d’osciller sur le pavé de Baker Street avant d’oser frapper à sa porte. Il n’a en revanche aucune idée des convenances. Il ignore même — on reparlera de ce scandale — qui est Madonna. Ce qui se chiffre et se déchiffre est son domaine. Ce qui pour la société relève de l’évidence, ce qu’il n’est nul besoin de lire parce que cela est, l’ensemble de cela lui est à l’inverse étranger.
Une permutation a donc lieu entre l’évident et le chiffré, l’aisé et le difficile, l’insignifiant et l’essentiel. Au milieu des préparatifs, Mary attirera dans un coin son promis pour lui demander de trouver une enquête pour Sherlock, manifestement perturbé par cette effervescence à laquelle il n’entend rien. « He’s youtubing serviettes », note-t-elle pour montrer à quel degré de délire il en est arrivé. Et elle attirera Sherlock dans un autre coin, lui demandant d’intervenir de pareille façon auprès de Watson. Les deux hommes partiront sur de nouvelles pistes, ravis et persuadés de rendre service. Mais en vérité chacun retourne, soulagé, à ce qui le comble, ces crimes dont il a moins peur que de devoir dresser un plan de table ou choisir un gâteau.
Une série est toujours une diversion, une distraction : on la regarde dans le creux des jours, dans l’intervalle entre deux activités moins futiles ; on y retourne avec la conviction qu’on devrait être affairé ailleurs, en pensant à la fois confusément et obstinément à autre chose. Peine perdue : ce sont les séries elles-mêmes qui sont autre chose, l’autre chose de vies au sein desquelles, dès lors qu’on s’y intéresse, va commencer de se défaire le rapport réglé entre ceci et cela, ce qui importe et ce qui n’importe pas.
Le sujet d’une série a toujours à voir avec cela, la distraction, la diversion, la digression. L’existence qui passe soudain à côté d’elle-même, l’ouverture d’un sas qui, sans rien changer, rend tout différent : lorsqu’il eut franchi la porte, les fantômes du permanent vinrent à sa rencontre… Le couple de The Americans est condamné à jouer les espions alors qu’il aimerait pouvoir mener une vie de famille comme les autres, et non pas coller seulement au mensonge ou au mirage de cette vie. Le scientifique de Masters of Sex, inversant à son tour le jeu du travail et du plaisir, met la sexualité in vitro pour mieux en esquiver la difficulté in vivo. Les deux policiers de True Detective découvrent un peu tard que c’était à la poursuite d’eux-mêmes qu’ils étaient lancés, pendant tout ce temps.
C’est la même chose encore ici. Ou l’inverse, l’inversion de l’usuelle inversion sérielle qui met la distraction au centre et le centre à la périphérie. L’épisode présente enfin les enquêtes pour ce qu’elles ont toujours été, une fuite, un recours, une diversion. Le rapport, vertical, du fond et de la surface — fond des signes à produire au grand jour, fond de l’enquête opposé à la surface du quotidien — s’y donne également comme rapport horizontal de l’occupation et du loisir. « The Sign of Three » n’est donc pas à côté des autres, un épisode qui ne compte pas, une pause. Corrigeons : il l’est, mais dans l’exacte mesure où il montre combien le genre sériel est lié à l’articulation de ce qui compte et de ce qui ne compte pas, du chiffré et du sans-chiffre, du travail acharné et du désœuvrement.
Sherlock Holmes, celui de Conan Doyle comme celui de Gattis et Moffat, est la plus grande machine déchiffrante qui se puisse imaginer. L’innovation de la série au regard des précédentes adaptations loge dans les moyens contemporains qu’elle mobilise afin de rendre sensible le génie holmesien à cet égard. Le discours qui lit le monde comme dans un livre ouvert ne suffit plus, ici. Il s’accompagne de trucages et d’effets transformant le détective en GPS du futur. Sherlock voit et nous voyons avec lui. Il voit la carte de Londres s’ouvrir devant lui, les rues par lesquelles il peut passer et celles où la circulation est bloquée. Il voit les SMS et ceux-ci s’affichent en 3D, comme s’ils bougeaient avec nous ou que nous pouvions les traverser, passer derrière… Il visualise telle chat room d’Internet sous la forme d’un amphithéâtre d’université où il peut se transporter à l’envi. Il voit l’usure d’une étoffe, la teinte d’une peau, et tout cela se trace en noms, dates et chiffres. Il déchiffre. Il ne cesse de traduire, de retraduire. La déduction est donc devenue, en même temps qu’un travail de lecture, la production d’informations présentées dans un langage de graphes, de courbes et de statistiques que nous connaissons bien. Ce langage est moins celui de Conan Doyle que celui du journalisme moderne, moins celui de la littérature que celui de CNN ou des applications pour smartphone.
Sherlock est comme la télévision : ignorant ou dédaigneux de l’humanité.
Le détective le dira au cours de l’une des circonvolutions d’un discours qui n’en finira pas, semblant passer par tous les genres, prétéritions longues comme le bras, autobiographie, apologue, hagiographie, attaque puis défense du mariage, etc. Watson, confiera-t-il au moment de tracer le portrait de son ami, a un talent que lui n’a pas : le premier sauve des vies alors que le second ne résoud jamais que des affaires. « Case » est le mot que Sherlock emploie alors. En français cela donnerait « affaire », mais aussi « cas » et même, pourquoi pas, « case ». Sherlock est l’homme sur le chemin de qui ne se présentent jamais que des cas. Et il est l’homme pour qui il est toujours possible de résoudre un cas parce que celui-ci, aussi tordu soit-il, tombe toujours dans quelque case d’avance découpée par lui. Watson est médecin. Il se soucie des hommes, il lui importe qu’ils vivent ou meurent. Sherlock pas du tout. Seule la résolution de l’énigme le concerne : l’humanité, par ailleurs, peut bien aller à sa perte.
« Case », en anglais, appartient au vocabulaire de la classification scientifique ou policière. En français il appartient aussi au vocabulaire de la télévision : les cases d’une grille, les cases d’un programme… Le Sherlock Holmes de Gattis et Moffat n’est à bien des égards que cela : l’autre nom de la programmation, l’autre nom de la télévision. Sherlock est comme la télévision : ignorant ou dédaigneux de l’humanité, il est une machine dont l’efficacité vient de ce qu’en tout, il ne considère pas le vivant mais la case. Non pas le présent mais le représentatif, non pas le sujet au sens de « subjectivité » mais le sujet au sens de « thème ». Non pas le singulier mais le thématisable, fût-ce la thématisation du singulier.
Pour la télévision, pour Sherlock Holmes, seul existe le catégorisable, le généralisable. Pas d’exceptions, sauf celles qui confirment la règle. Jamais d’indéchiffrable. Que du chiffré qui ne demande à qu’être déchiffré, y compris au moyen d’autres chiffres. Rien qui puisse être sans chiffre, hormis cette affection qui lie parfois les hommes et dont l’aveu laisse coi, ainsi qu’il arrive quand Watson vient trouver Sherlock pour lui demander si, étant son meilleur ami, il accepterait d’être son témoin. Sherlock feindra de prétendre, lors de son discours, avoir fait alors une longue réponse brillante et circonstanciée. Il fut en vérité incapable de décrocher un mot. Il demeurera là, à fixer bouche bée l’œil qu’il observait il y a quelques minutes et qui désormais remonte à la surface de la tasse de thé où sa surprise l’a laissé choir. Tout refait surface, plein cadre, pour Sherlock. Il est comme une caméra de surveillance qui ne s’éteindrait jamais, comme un œil total capable de voir à travers tout. Ou presque. Quant au reste, il le voit si peu qu’il le rejette hors de son orbe, loin dans les ténèbres de l’inexistence. C’est ce qui se produit quand Watson vient le trouver : la machine, soudain, tombe en panne.
Masters of Sex invitait il y a peu à parler de télévisualisation afin de décrire un processus commun à bien des séries. Processus en deux temps. Le premier consiste à descendre au sous-sol du visible, le second à en remonter les bras chargés de ce que d’ordinaire on ne saurait voir : l’ambiguïté, la sexualité, les perversions, les cadavres… Il en va ainsi encore dans Sherlock : il faut aller dans tous les recoins de Londres où ont lieu les crimes, et parfois même jusqu’aux plus reculés des couloirs de ce métro dont les scénaristes s’amusent qu’on l’appelle, précisément, Underground. Il faut toujours aller sous terre, dans une série… Y aller pour en revenir, avec l’idée de n’avoir pas à y redescendre, l’idée qu’il est possible que les ténèbres soient à jamais vaincues. La télévisualisation nomme ce travail. Elle nomme le projet d’un voyeurisme intégral auquel ne serait pourtant attachée aucune des connotations négatives du voyeurisme, puisqu’il s’agit de tout y voir de la même façon, sous la même lumière sans ombre, et pas seulement l’intime, le sordide ou le déviant.
La télévisualisation telle que Sherlock la pratique est bien un tel labeur d’excavation, mais dénué des lenteurs et des précautions de méthode chères, par exemple, au docteur William Masters. On ne l’a jamais vue si brutale ni si perfectionnée. C’est désormais sans délai qu’elle agit, sans délai et comme une seconde nature. Ce que les autres ne voient pas se présente d’emblée à l’esprit et à la vue de Sherlock, au moyen de trucs qui à la fois forcent l’admiration et fatiguent vite, par leur outrance.
Télévisualisation est un mot qui voudrait avoir une valeur polémique. Le nouvel âge d’or des séries, l’évidence qu’elles sont devenues un art majeur de notre temps ne doit pas faire croire en effet qu’une rupture complète aurait eu lieu, entre la télévision honnie d’hier, où la critique se plaisait à reconnaître l’ennemi public numéro un, et la télévision admirée d’aujourd’hui. Les lecteurs du troisième tome de ses écrits — recueillis chez POL — savent avec quelle insistance, au cours de la deuxième moitié des années 1980, Serge Daney vilipenda sous le nom de programme tout ce qui, venu de la télé, lui semblait menacer le cinéma en y empêchant la survenue de tout imprévu. Programme qualifiait négativement, sous sa plume, l’ensemble de ce qui tendait à troquer les aléas de l’enregistrement contre les calculs du déjà vu, à remplacer l’invention d’images par des stocks de visuel, à noyer le singulier sous les cas et les cases.
Ces textes ont trente ans, sans doute. La situation du cinéma et de la télévision a changé, sans doute. Il n’est pas vrai, cependant, qu’il n’y a plus de programme, littéral et métaphorique, dans les séries contemporaines. Masters of Sex est l’histoire d’une « study », d’un programme de recherche scientifique. Breaking Bad narre une mort programmée et s’ouvre par un générique dont les soixante-deux cases reproduisent celles de la table de Mendeleïev et correspondent en outre au nombre d’épisodes qu’aura eu la série au terme de ses cinq saisons. Ce n’est donc pas parce que la télévision serait devenue un art qu’elle aurait entièrement cessé de penser par programmes et de distribuer autour d’elle des regards qui cadrent et classent. Les séries actuelles peuvent bien être supérieures à nombre de films, cela n’empêche pas que s’y poursuive l’effort d’enquête quelque peu malsaine et normative sur le visible à laquelle on a coutume de résumer l’entreprise télévisuelle. Les séries se cinématographisent, certes. Mais Sherlock moins que True Detective, par exemple, où la télévisualisation continue de braquer ses projecteurs sur le moindre recoin sombre, ne s’intéressant au secret qu’à la condition de pouvoir le publier, ne descendant au sous-sol qu’afin de procéder à une remontée à la surface, illico et manu militari.
D’un autre côté, ce n’est pas parce que la télévision demeure la télévision que l’ayant compris il faudrait soudain détourner les yeux. Il y a bien dans Sherlock une forme d’obscénité à vouloir tout dire, tout éclairer, tout exprimer, à vouloir que tout parle et que tout soit parlé. La série en fait des tonnes. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas lui accorder notre attention.
Or il se trouve c’est de cela que traite, avec beaucoup d’intelligence et même d’humilité, l’épisode 2 de la saison 3. On nous y parle de la télévisualisation comme vision et comme super-pouvoir, mais aussi comme travers. De la toute-puissance, mais aussi de la dérision du programme, de la possibilité d’en sortir, des diversions et des digressions à notre portée pour cela… « The Sign of Three » introduit le rôle du best man comme contre-emploi parfait, pour Sherlock. Plus largement, le témoin, son innocence et sa bienveillance, son dénuement et son retrait, y apparaît comme la figure qui s’éloigne a priori le plus de ce dont la télévision est capable. La télé a beau multiplier les appels à témoin, il n’empêche : elle ne témoigne jamais. Elle renseigne, elle étudie, elle enquête : rien à voir. D’où le caractère en tous points exceptionnel et révélateur d’un tel épisode.
Sherlock y continue d’abord d’être celui qui programme tout, même ce qui n’a pas lieu de l’être : les serviettes de table, les invités, les amis de Mary… Pour la soirée d’enterrement de vie de garçon, il ira jusqu’à évaluer au millilitre près la quantité de bière que, aux différentes stations de la tournée les conduisant dans chacune des rues où ils trouvèrent un cadavre, Watson et lui pourront boire sans risquer d’être ivres. Mais le premier profitera des passages aux toilettes de son ami pour boire un peu plus, et le second semble pour une fois s’être trompé dans ses calculs. Les deux amis atterriront donc au poste ronds comme des coings, avant de rentrer à la maison la queue entre les jambes. C’est sans doute qu’il y a de l’humain, malgré tout. De l’improgrammable, de l’in(dé)chiffrable. Et que le bon Watson est là pour le rappeler, de temps en temps. Mais pas seulement, pas essentiellement.
Peut-être est-ce plutôt que ce n’est que par le programme que la télévision peut espérer échapper au programme. « The Sign of Three » avance deux autres solutions. La première consiste à montrer que la déduction lui est devenue un talent si naturel et irrésistible qu’il arrive à Sherlock de procéder à des conclusions qu’il ne lui reste ensuite qu’à regretter. Ainsi d’un invité dont il repère inconsidérément les troubles érectiles. Ainsi surtout de la grossesse de Mary, qu’à certains troubles — changements d’humeur, altérations du goût… — il a le premier comprise, et qu’il ne peut s’empêcher d’annoncer, portant son toast à « vous trois ». Sherlock est comme tous les héros de série, comme Tony Soprano, comme Walter White : il est enchaîné à son talent, à sa puissance comme à quelque chose dont au fond il n’a pas le contrôle et qui, plus souvent qu’à son tour, opère et s’exprime à ses dépens. Autre remontée à la surface, autre télévisualisation.
La seconde solution apparaît dans une superbe scène de comédie au cours de laquelle les deux amis, rentrés ivres au 221B, s’adonnent à ce jeu remis à la mode par le film Inglorious Basterds de Quentin Tarantino, dans lequel le colonel Landa, campé par Christoph Waltz, empruntait d’ailleurs certains traits au détective britannique. La règle est simple : on colle une étiquette portant un nom sur le front de son voisin. Celui-ci pose alors des questions afin de découvrir « qui il est ». Watson est « Madonna » et Sherlock Holmes, il fallait y penser, « Sherlock Holmes ». L’ivresse des compères ne facilite pas la progression de la partie. Il apparaît en sus que Sherlock n’a aucune idée de qui est Madonna, ayant pioché son nom au hasard dans le journal. Il apparaît enfin qu’il n’a pas davantage idée de qui il est. Les questions qu’il pose — « suis-je humain ? », « suis-je intelligent ? », « les gens m’apprécient-ils ? » — et les réponses qu’apporte Watson en riant sous cape le portent en effet à penser que ce n’est pas son nom, mais celui de son ami, dont son front est ceint.
Révéler l’évidence même comme épaisseur, faire saillir l’élémentaire comme l’énigme même.
C’est une autre façon de sortir du programme par le programme. Non pas en faisant valoir une visibilité telle qu’elle foudroie toute ambiguïté pour faire apparaître un monde intégralement lisible, devenu texte, ainsi que Sherlock s’y emploie, et d’autres séries avec lui, de manière moins grossière, moins extravagante aussi. Non pas montrer que la tâche de lire et de déchiffrer peut parfois s’exercer par inadvertance et à mauvais escient, qu’il y a parfois des sorties de route, un délire dans le quadrillage, des ratés dans le programme et donc un peu de vie enfin. Mais révéler l’évidence même comme épaisseur, faire saillir l’élémentaire — votre nom, celui d’une star mondiale — comme l’énigme même. Non pas déchiffrer à l’infini et parfois indûment, mais rechiffrer, reprogrammer, encore et toujours, même ce qui est si connu qu’on croirait n’avoir plus besoin de le lire.
Il y a bien sûr une affaire, dans « The Sign of Three », un crime. Celui-ci est bien sûr emberlificoté au dernier degré, et bien sûr il finira par surgir sur la scène de la noce et redonner ses droits à l’enquête. Mais il restera secondaire. Son secret restera dissimulé derrière le secret de l’évidence, derrière l’énigme de l’ordinaire. Cette énigme, ce secret sont peut-être ce après quoi court toute série. Et peut-être sont-il aussi ce qui lui demeurera inaccessible tant qu’elle s’obstinera à quadriller et à calculer plutôt qu’à, simplement, voir — à supposer qu’une telle chose ait un sens.
L’heureux John Hamish Watson — voir le running gag lubitschien sur la révélation de son deuxième prénom et le jeu croisé des « Yep » et des « Nope » —est logiquement le véritable héros de « The Sign of Three ». Watson est interprété par un acteur remarquable, sobre et expressif à la fois, l’aménité et l’attention même : Martin Freeman. Freeman a récemment été le second couteau de trois séries. En 2001 il fut Tim Canterbury aux côtés de David Brent dans la version originale britannique de The Office. Il y fut le rêveur aspirant à une autre vie que celle du bureau, aux côtés du patron entertainer plein de lui-même interprété par Ricky Gervais. Depuis 2010 il est le docteur Watson, retour d’Afghanistan — comme chez Conan Doyle —, aux côtés de Sherlock Holmes et de Benedict Cumberbatch, acteur plus cabot mais non moins inspiré que lui. Et depuis quelques mois il est Lester Nygard aux côtés du Lorne Malvo que campe Billy Bob Thornton, dans l’étonnante adaptation, sous le même titre et pour FX, du Fargo des frères Coen.
Un dernier mot à ce propos, pour conclure et prendre date en vue d’une prochaine fois. Ces trois seconds rôles marquent trois étapes de la relation entre télévision et visibilité, télévision et (dé)chiffrement. D’abord, l’invention par Gervais et Merchant, avec la série la plus influente du millénaire débutant, du faux documentaire — mockumentary — comme nouvelle règle comique, violence désormais adoptée par un genre s’attachant à exposer ceux qui, bien que banals pékins, s’entêtent à se prendre pour des stars. C’est déjà la fin du secret, au profit d’une transparence totale qui retourne l’aspiration à la gloire en ridicule et, surtout, en honte. Grandeur de The Office, horreur d’un monde devenu une scène sans coulisses, cauchemar de la télévisualisation. Ensuite, l’actualisation de textes littéraires vieux d’un siècle à l’ère des SMS et des chaînes d’information continue. Le Sherlock Holmes nouvelle manière n’élève pas de la poussière mais voit la totalité de ce qui arrive s’imprimer en gras sur un écran devenu un ordinateur, une table d’informations, un iPad. Que des chiffres, mais plus de chiffres aussi bien, au sens cette fois de secrets, puisque tout ce qui paraît est aussitôt tracé, lu, rangé. Sherlock n’oppose pas une profondeur et une surface. Il oppose la surface commune à l’hyper-surface constituée de ce que le détective ne peut pas ne pas voir.
Et pour finir, l’adaptation d’un succès des années 1990, d’une manière qui doit moins en vérité au cinéma qu’à la situation d’un genre marqué par la domination de Breaking Bad. Dans la série Fargo, la neige du Minnesota succède au désert du Nouveau Mexique, les valises d’argent qu’on enterre succèdent aux bidons, mais c’est la même dispersion en événements insensés et en bifurcations incongrues. Errances et récits en miettes. Émiettement, aussi, de la référence cinématographique. Même humour pince-sans-rire, même maniérisme sans manière. Tout s’efface et tout affleure dans la neige : l’argent, le sang, les frustrations… Tout est secret, rien n’est secret. Ni tréfonds ni ténèbres, fussent-elles dissipées par les lumières aveuglantes de la télévisualisation. Un nouveau rapport au déchiffrement et à l’indéchiffrable s’ouvre avec Fargo, pour une télévision qui entre ainsi dans une autre ère encore, celle de l’après Breaking Bad.
Post-scriptum
Emmanuel Burdeau est critique de cinéma.