Des chaînes pour la neige. 1 sur la série « Fargo »
par Emmanuel Burdeau
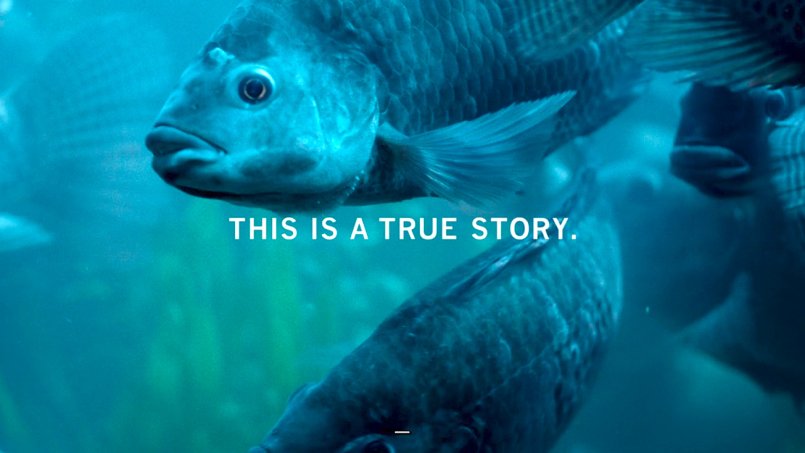
Jeter un gant par la fenêtre d’un train, après avoir perdu l’autre, pour qu’on puisse recomposer la paire, c’est offrir le hasard au hasard, mais aussi bouleverser l’ordre d’un récit construit sur les conséquences de rencontres et de gestes tout aussi hasardeux. Les dix premiers épisodes de Fargo, la série de Noah Hawley, entrelacent ainsi des récits flottants qui s’élèvent sur le retour incessant d’un fond blanc de neige et des rotations du tambour d’une machine à laver. Premiers pas parmi une arborescence dont le chiffre est en permanence à reconstituer.
La chaîne FX a diffusé au cours du printemps 2014 les dix épisodes de la première saison de Fargo, série créée par Noah Hawley d’après le film, sorti en 1996, de Joel et Ethan Coen, ici producteurs exécutifs.
Le huitième épisode, programmé au soir du 3 juin, s’ouvre en musique, sur les images d’une chaîne d’usine où sont assemblées des machines à laver le linge. L’une d’elles est destinée à Lester Nygaard. À ce stade, le spectateur sait quelle étrange apothéose cette acquisition signifie pour l’employé de Bo Munk Insurance. C’est en effet à cause de l’ancienne machine des Nygaard que tout avait commencé. Au petit-déjeuner, Pearl s’était plainte du boucan montant du sous-sol ; elle avait geint que le ménage n’ait pas les moyens d’acheter une nouvelle machine ; elle s’était même lamentée qu’au lieu de Lester elle n’eût pas épousé son frère Chaz.
Lester n’avait su que dire. Trop gentil, trop timoré. La journée n’était allée ensuite qu’en empirant. Lester avait rencontré dans la rue ce butor de Sam Hess et en était ressorti avec le nez cassé. Par sa faute : dans sa panique, Lester s’était tout bonnement jeté la tête la première contre une vitrine.
À l’hôpital il était abordé par une créature patibulaire et compatissante. De but en blanc, celle-ci proposait de le soulager en tuant Hess. Lester n’avait su encore que dire. Et bientôt tombait la nouvelle de la mort de Sam. Le choc l’avait terrassé mais galvanisé, aussi. Le petit garçon se sentait maintenant prêt à agir en homme. Pour commencer il s’attelait au plus urgent, la réparation de la machine à laver. N’y parvenant pas, il devait subir les moqueries sempiternelles de Pearl. Une fois de plus, une fois de trop : d’un coup de maillet, le timide assureur fermait à jamais le clapet de la mégère.
Sept épisodes plus tard, Lester Nygaard n’est plus le même. Il a su détourner les soupçons de la police vers son vantard de frère et sa collection d’armes. Il couche avec la veuve Hess, sa belle-sœur fait preuve de sollicitude à son égard, sa collègue Linda le trouve craquant… Tout va bien. Et pour fêter ça il s’offre une nouvelle machine.
Que de détours et de bifurcations, que d’embranchements et d’enchaînements aussi incongrus qu’irrésistibles pour en arriver là, à cet autre enchaînement, cette chaîne sur laquelle sont assemblées des machines à laver que dans un instant on va mettre en boîte puis charger dans un camion. Fargo avance en croisant des chemins et des trajets qui, en toute logique, n’auraient jamais dû entrer en rapport. La série de Noah Hawley s’écrit par gestes peu prémédités et rencontres de hasard dont il faut pourtant subir toutes les conséquences, mais aussi, bien souvent, recomposer en amont l’entière généalogie. L’ironie du sort, cet art de raccorder les unes aux autres des causes et des effets qui ne se ressemblent pas, est une ressource chère au genre sériel. Elle est mise en œuvre ici avec une délectation particulière, sinon avec un brio inédit.
Hawley brouille les pistes. Il les brouille d’autant mieux que l’ensemble demeure parfaitement clair et comme immaculé. Cette virginité, c’est bien sûr celle des étendues de neige autour de la petite ville de Bemidji, dans l’État du Minnesota. C’est le blanc sur quoi tout relief peut surgir et qui, aussi bien, peut recouvrir n’importe quel événement pour le renvoyer au nul et non avenu.
L’image du manteau hivernal n’est pas neuve. Mais elle est opportune. Paraissant à intervalles réguliers, elle exprime combien les possibles narratifs s’enlèvent sur un grand fond indifférencié. Une autre image est celle des rotations du tambour de la machine. Dès l’instant où Lester croise fortuitement la route de Lorne Malvo — c’est le nom de la créature —, venu en ville pour un tout autre motif — l’homme est tueur à gages —, il entre dans une centrifugeuse, un échangeur d’existences dont il ne pourra ressortir indemne. En outre, si la machine des Nygaard fonctionne encore, ce n’est pas sans émettre un bruit affreux. Cela tourne mais cela percute, aussi : ces percussions sont le bruit de la fatalité en marche. Sept épisodes plus tard, la chaîne de l’usine présentera à son tour un portrait du destin en marche. À ceci près, qui change tout, que celui-ci aura entre-temps inversé son signe.
L’ouverture du huitième épisode n’est pas une exception. D’autres épisodes de Fargo démarrent de la sorte. Non dans la continuité du drame mais un peu avant ou un peu après. À côté, dans la marge. Soulignant par là l’arbitraire semblant tirer les possibles d’un grand sac. Impunément voire, dirait-on, à l’aveugle.
Le troisième épisode commence dans un bureau, à gauche au fond d’un couloir. Assis à son ordinateur, un comptable jette des regards inquiets par-dessus son épaule. Apparaît Lorne Malvo, qui l’attrape par la cravate et le traîne sur la moquette, jusqu’à un parking où il lui ordonne d’enlever ses vêtements et de se glisser dans le coffre d’une voiture. L’homme, a-t-on compris, n’a pas payé ses dettes de jeu. Et la scène, comprendra-t-on, prend place juste avant l’ouverture du premier épisode. Celle-ci montrait en effet Malvo conduisant de nuit, sur fond de radio et de grognements étouffés.
Le cinquième épisode s’ouvre l’été. Les blés sont en fleurs, Lester fait des courses. Décor : une boutique où l’on vend de tout. Comme les chaussettes des hommes ont été mélangées avec celles des femmes, le client est libre d’en donner le prix qu’il veut. Lester hésitant, le patron lui propose — étrange geste commercial — une ristourne s’il prend en sus la carabine accrochée au mur que le spectateur a déjà rencontrée. Déjà, ou pas encore. C’était plus tôt dans l’ordre du récit, mais plus tard dans celui de la chronologie. Lorsqu’au premier épisode la police sonn(er)ait à la porte de Lester, son épouse gisant au sous-sol, Malvo l’accueill(er)ait l’arme à la main.
Le sixième épisode s’ouvre quant à lui dans un restaurant asiatique. Des poissons sont sortis d’un aquarium, passés à la poêle puis décapités, assaisonnés, servis enfin à une table où le Parrain de la mafia locale écoute le rapport d’un collaborateur, tout en prêtant une oreille aux propos des autres commensaux. Il s’impatiente. Il aimerait qu’ait abouti l’enquête sur la mort de ce transporteur routier de Bemidji, Sam Hess, avec qui il partageait certains intérêts.
Des machines que d’autres machines achèvent de monter dans un grâcieux ballet mécanique ; un corps qui glisse sur le sol ; un objet acheté à la place ou en plus d’un autre ; une tête coupée d’un geste net. Des poissons dans leur aquarium : celui d’un restaurant, mais aussi celui que leur fait le fond d’écran d’un ordinateur de bureau — c’était le premier plan du troisième épisode —, et d’autres aquariums encore, d’autres poissons, numériques, dessinés ou réels, affichés au mur ou, nouvelle plaie d’Égypte, tombant du ciel par centaines.
Ces jeux sympathiques ou sanglants avec les flux et avec leur coupure, leur prolongation ou leur interruption, leur tension ou au contraire leur giration, leur caractère télécommandé ou fortuit, absurde ou lourd de trop de sens, sont ceux d’une série qui ne procède pas linéairement. Faire des ronds dans l’eau ; traîner ou trancher ; dévier ; tirer sur la corde ou à l’inverse couper court. Assembler, désassembler : Fargo prend et laisse, membre et démembre ses histoires où bon lui semble.
Noah Hawley aime les discontinuités. Douces, brutales. Celles qu’on a dites, d’autres encore. Personnages introduits à mi-parcours et prenant le train en marche, ruptures de ton, changements de décor, violences que rien ne prépare. Discontinuités si nombreuses et bientôt si familières qu’il arrive un moment où c’est la continuité qui finit par paraître incongrue. Une audace et non une nature. Cela se produit d’exemplaire façon lorsque, sans coupure aucune, un long travelling latéral à l’orée d’une forêt quitte Gus Grimly en policier tétanisé par les risques du métier pour le retrouver dans l’uniforme de facteur qu’il a toujours ambitionné de revêtir. D’un bout à l’autre du mouvement d’appareil, nul autre indice de transformation que ce changement de costume, auquel correspond un changement de véhicule de fonction, et que l’inscription de ces mots, au centre de l’écran, « One Year Later ».
Fargo congédie le modèle d’une narration centrée avec héros central et figures secondaires. C’est plutôt une arborescence, des cristaux d’histoire tombant dans toutes les directions à la fois. Lester Nygaard, l’assureur transfiguré, interprété par Martin Freeman, acteur précieux déjà vanté dans ces pages ; Lorne Malvo, joué avec gourmandise par l’excellent Billy Bob Thornton, tueur laconique, manipulateur et parfois facétieux, convaincu que l’homme demeure une bête, un gorille à peine dégrossi ; Gus Grimly, le policier malgré lui devenu facteur, père de l’adorable Greta ; Molly Solverson, l’inspectrice de Bemidji, empotée d’abord puis de plus en plus futée, et qui se mettra en ménage avec Gus : tous, à commencer par la dernière, pourraient revendiquer le statut de personnage principal.
Les dix épisodes de la première saison racontent moins leur histoire, de toute façon, qu’ils n’organisent leur croisement avant de les laisser s’égayer vers de nouveaux horizons — ou de les faire disparaître. La seconde saison, en cours d’achèvement, reprendra les survivants pour les plonger dans de nouvelles péripéties. On ne sait rien d’elles sinon qu’elles différeront du tout au tout avec celles de la première. Quant à celles-ci, leur caractère fragile et aléatoire se trouve encore augmenté de ce qu’elles viennent s’inscrire au sein d’un foisonnement d’autres histoires, narrées voire, parfois, brièvement mises en images.
Le spectateur peut ainsi entendre, délivré par un rabbin voisin de Gus, le récit de l’homme qui donna sa fortune, ses reins et bientôt sa vie, pour le salut de l’humanité. En vain, ne laissant derrière lui qu’une giclée de sang sur le mur de la salle de bain, accompagnée d’une autre inscription le désignant comme donneur d’organes. Le spectateur entendra également Malvo demander à Gus s’il sait pourquoi l’œil humain est celui qui distingue le plus de nuances de vert. (Réponse : parce que nous sommes foncièrement des prédateurs.)
Un agent du FBI consigné en salle d’archives à la suite d’une boulette monumentale proposera une énigme à son camarade d’infortune, sur le moyen de faire traverser une rivière à un lapin, un renard et un chou sans que l’un ne mange ou n’attaque l’autre. Le même agent s’interrogera sur la quantité de dossiers qu’il faudrait emporter avec soi, un par un et jour après jour, pour que la salle où ils sont changeant de nature, on ne puisse plus la considérer comme l’archive de quoi que ce soit. Question oiseuse, question abyssale. Question qui n’est pas sans concerner une série qui est un vaste conservatoire de récits, et dont une des préoccupations est bien le rapport, sinon du tout au rien ou du vide au plein, au moins de l’immaculé à la trace.
D’autres fables ou devinettes scandent encore Fargo. Le test prétendument scientifique des deux verres d’eau, l’un qu’on couvre d’insultes et l’autre à qui on susurre des mots doux. Le réfugié africain que le chef de la police de Bemidji se faisait fête d’accueillir, et dont il resta sans nouvelle jusqu’à le découvrir en train de chaparder dans les allées d’un supermarché. L’homme qui, monté dans un train, s’avisa qu’il lui manquait un gant et décida de jeter l’autre par la fenêtre, afin que celui qui trouverait le premier ait une chance de recomposer la paire.
La plupart de ces interrogations, méditations ou charades gardent un goût d’inachevé. Soit que le sens de leur morale paraisse incertain, soit qu’ils n’en aient simplement pas. Soit encore qu’un incident ou une distraction en interrompe la conduite avant terme. Toutes ces histoires semblent dès lors flotter deux fois. Une première fois au-dessus de celles des personnages, Molly, Lester, Lorne… Et une seconde fois au sein d’une dimension qui n’appartient qu’à elles.
Il ne s’agit pas de faire voir ou apercevoir l’ombre d’une loi gouvernant les destins, le poinçon d’un fin mot universel à décrypter, ainsi qu’il arrive dans True Detective, autre série où foisonnent les récits. De façon plus modeste et plus insaisissable, la recherche de Noah Hawley vise à suggérer un impalpable, à rendre sensible la qualité de l’air qui vibre autour de ses personnages.
À cet égard il y a peu de différence entre cette distribution-là, toute narrative, et celle qui place un peu partout des panneaux et des jingles, des affiches et des messages. Dans les maisons ou au bord des routes, sur la porte du réfrigérateur, au mur du sous-sol ou à la fenêtre d’une chambre d’hôpital. Il y a la météorologie propre aux rudes hivers du Minnesota. Mais il y a aussi la météo des histoires dites ou vues, et encore celle des inscriptions et des augures : autant d’avis de tempête ou, plus rarement, d’annonces de beau temps.
Toutes ces météos font signe. Mais ce n’est pas pour inviter l’homme à élucider le sens de son destin. C’est simplement pour lui rappeler que ce destin a toujours à voir avec quelque labeur interminable de chiffrement et de déchiffrement. Quelque alternative de neige fraîche et d’empreintes de pas. Ou de traces de sang.
La suite au prochain numéro…
Post-scriptum
Emmanuel Burdeau est critique de cinéma.

